Afrique : Des pouvoirs politiques traditionnels et de leur avatar démocratique post-occupation des territoires africains par des puissances européennes
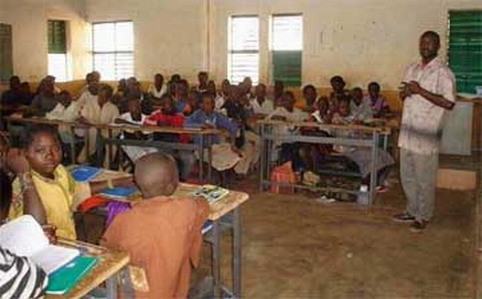
A travers cette tribune, Pierre Bamony visite et revisite les travaux et la pensée du Pr Joseph Ki-Zerbo. Cet article, dit-il, est une contribution au projet de réforme de l’éducation nationale du chef de l’Etat burkinabè.
Résumé
Le penseur Joseph Ki-Zerbo fait le bilan de son existence dans son dernier ouvrage, A quand l’Afrique ? Il s’agit de ses combats politiques pour que l’Afrique noire connaisse une voie de développement authentique (endogène), c’est-à-dire conforme à ses propres valeurs. Or le constat qu’il donne concernant les politiques et les figures de développement des pays africains postindépendance semble plutôt désastreux. Au regard des diverses trahisons des élites politiques africaines par rapport aux intérêts de leurs peuples respectifs qu’elles abandonnent à leur sort dans la misère, l’auteur accorde une grande importance à l’art de gouverner des pouvoirs politiques autochtones. Ils avaient un supplément d’âme quant au sort des peuples africains.
Il montre également ses propres échecs dans son engagement politique en Haute Volta/Burkina Faso. Car son « Mouvement pour la libération nationale », interafricain ou panafricain dont l’ambition était de libérer les peuples africains de toutes les tutelles et dominations politiques, étant jugé subversif par la puissance de tutelle, en l’occurrence la France, et ses suppôts à la tête des pays africains dits indépendants, n’a pu trouver sa place dans aucun régime politique de son pays. Il mentionne rapidement ses rapports avec Thomas Sankara en 1983 et les raisons de son exil.
En somme, cet ouvrage de Joseph Ki-Zerbo donne à penser en nous éclairant sur le destin de l’Afrique noire. Le concept de « colonisation », sous sa plume, a été, en premier lieu, questionné.
Introduction : l’erreur au sujet du concept de « colonisation »
J’ai été étonné de constater, à travers l’immense œuvre historique autant que ses autres ouvrages que le grand penseur et savant Joseph Ki-Zerbo n’ait pas prêté suffisamment attention au terme de « colonisation » s’agissant des pays de l’Afrique subsaharienne. Car il en fait un usage continu jusque dans ses derniers ouvrages. La notion de « colonisation » est un mésusage ou une mauvaise interprétation des données historiques. En effet, il importe que les historiens français et africains tranchent l’ambiguïté de ce terme « colonisation » s’agissant des territoires occupés en Afrique noire depuis le milieu du XIXe siècle par les Européens, français, anglais, portugais, etc.
En Algérie, en Afrique du Sud, on peut parler de colonisation puisqu’il s’est agi de conquérir un pays, de le dominer et de tâcher de le mettre en valeur ou de l’exploiter économiquement à son profit. Les terres des Amérindiens en Amérique du Nord et du Sud ont été colonisées par les Européens. Le mot colonie vient du latin colere qui signifie mettre en culture, cultiver. Ainsi, dans l’Antiquité gréco-romaine la colonie désignait un groupe de gens qui quittaient leur région d’origine et mettaient en culture une région en friches, comme les Européens l’ont fait en Amérique ou en Afrique du Sud. Pour ce qui est des territoires de l’Afrique subsaharienne, il s’agit bien d’une conquête, certes, mais davantage d’une occupation ayant pour finalité de faire travailler les populations locales en vue d’enrichir les métropoles européennes par un apport considérable de matières premières nécessaires au développement des industries européennes.
Concernant les pays francophones en Afrique noire, la donne n’a jamais changé substantiellement de nature ni de forme : les pays africains continuent toujours de fournir les industries françaises en matières premières indispensables : le Sénégal pour l’arachide, le Gabon pour le bois, l’hévéa, le pétrole, etc., la Côte d’Ivoire pour le café, le cacao, le bois etc. D’où la création de la Françafrique pour maintenir ce statu quo et défendre les intérêts de la France en Afrique noire, coûte que coûte .
Ainsi, les pays africains francophones, en vertu du « Pacte colonial », avaient un statut similaire au servage des paysans du Moyen-âge européen, sous et au cours de la post-occupation. En effet, il s’agissait d’un système d’exploitation économique qui privait de liberté, de volonté les individus et qui instituait une dépendance par rapport aux nations européennes dominantes ; voire une figure de soumission à celles-ci. Dans le cas des peuples des pays africains subsahariens, ceux-ci dépendaient de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et du Portugal.
Dans ses travaux, Joseph Ki-Zerbo a pris acte de l’existence et de l’usage traditionnel du mot « colonisation » sans l’interroger pour savoir si ce terme correspondait bien au type de domination de certains pays européens, tels que ceux cités ci-dessus, sur la zone de l’Afrique subsaharienne. Pour les intellectuels de son époque et même pour ceux d’aujourd’hui, c’est un mot opérant qui donne une certaine compréhension des faits historiques dans les rapports Europe/Afrique d’antan et d’aujourd’hui.
C’est dans ce cadre que se situe la conception de Joseph Ki-Zerbo des formes de pouvoirs traditionnels et celle qu’on pourrait qualifier de « moderne ». Il montre qu’effectivement, contrairement à la volonté de négation des Occidentaux qui pose, par croyances culturelles, que les peuples noirs n’ont pas d’histoire, eh bien, en dehors de l’Égypte ancienne, dans la zone sub-soudanais, les vastes territoires de l’Afrique noire ne pouvaient fonctionner sans l’existence de pouvoirs politiques solides et forts.
Donc, les pouvoirs politiques traditionnels ont bel et bien existé avant la rencontre avec les peuples étrangers ; et qu’ils existent toujours sous diverses formes selon les pays de cette vaste zone au sud du Soudan. Dès lors, l’Afrique noire n’a jamais été une « Terra incognita », soit une terre inexplorée, donc inhabitée et inconnue de personne. Elle n’a pas attendu l’arrivée des peuples étrangers pour déployer son histoire ; soit celle d’un ensemble de peuples. C’est certains aspects de ces pouvoirs politiques traditionnels que Ki-Zerbo analyse dans son dernier ouvrage .
Autant il semble idéaliser ou apprécier ceux-ci, autant il examine de manière très critique leur avatar moderne connu sous l’étiquette de démocratie. Il souligne les limites des formes et des modes de fonctionnement de ces prétendues démocraties en Afrique noire. Selon lui, elle se sont complètement fourvoyées à la fois par rapport à l’exercice du pouvoir politique traditionnel et aussi par rapport aux pratiques de la vraie démocratie telle qu’elle se vit dans les pays européens et dont certains pouvoirs africains ont copié et tentent de d’imiter maladroitement faute d’avoir maîtrisé suffisamment les principes fondamentaux. Leur imitation s’apparente à une mascarade au sens où celle-ci est imparfaite.
I – Le mode de fonctionnement des pouvoirs traditionnels
La citation ci-dessous donne le ton, le sens et l’enjeu des antinomies soulignées par Joseph Ki- Zerbo quant à ses analyses portant sur les deux figures des pouvoirs traditionnels et de leur avatar contemporain chez les peuples africains subsahariens. « L’État africain traditionnel était une instance de gestion du bien commun et des décisions prises pour le compte de toute la cité, de tout le royaume.
Il a été détruit, écrasé par la colonisation, et dans le meilleur des cas, remplacé par de nouvelles formes de régimes démocratiques auxquelles les Africains n’étaient pas habitués et dans lesquels ils ne pouvaient pas se reconnaître ni se mouler comme on le fait dans les pays européens » (p. 82). Dans cette affirmation, tout indique que l’auteur semble souligner la qualité des pouvoirs traditionnels qui donnent la primauté et la priorité à la saine gestion des biens communs dans le sens de l’intérêt de tous.
A l’inverse, les systèmes politiques sous leur figure de démocratie légués par les occupants européens, cette soi-disant démocratie paraît tout à fait étrangère aux modes de fonctionnement politique et économique des peuples africains. Car, comme on le voit partout dans les pays africains subsahariens, tout indique que, si ce ne sont pas les peuples eux-mêmes qui manifestent une certaine inadaptation à la démocratie à l’européenne, du moins, les élites politiques issues des écoles (primaires, secondaires, universitaires) semblent réfractaires à l’exercice rigoureux d’un tel mode de gouvernance.
Même relativement proches par le niveau des études, à l’évidence la démocratie leur semble tout à fait étrangère. Quiconque doute de la véracité de cette thèse, qu’il donne quelques exemples prouvant le contraire dans les pays de l’Afrique subsaharienne ; plus particulièrement dans les pays de l’Afrique francophone, à l’exception du Sénégal.
En revanche, dans les pays anglophones de l’Afrique subsaharienne, même si les processus électoraux sont imparfaits, souvent biaisés ou manipulés, il n’en demeure pas moins qu’il y a, par-ci par-là, l’alternance des régimes politiques. C’est le cas au Ghana, en Afrique du Sud, au Nigéria, au Kenya, etc. En ce qui concerne les pays francophones, d’une manière générale, l’on accède au pouvoir à la faveur d’un parti politique créé à cette occasion, pour y mourir comme Houphouët-Boigny, Idriss Déby Itno, etc., même si l’on nuit, par son action politique, aux intérêts généraux des peuples. Telle est l’une des raisons pour lesquelles, Joseph Ki-Zerbo souligne les avantages des pouvoirs politiques traditionnels.
Tout d’abord, l’auteur prouve que l’on peut parler de l’exercice ou de la gouvernance démocratique dans les pays africains antéoccupation. En effet, dans le concept de démocratie, il se réfère aux éléments proprement africains, qui permettent de faire usage de ce terme et de montrer l’application adéquate dans les régimes politiques traditionnels. Selon lui, il y a eu une importante participation des différentes catégories de la population dans la manière de gouverner. Celles-ci participent au partage du pouvoir, voire à la limitation de ses excès, le cas échéant.
C’est ce qui, entre autres facteurs, est le nœud de la solidarité des différents peuples africains. Toutefois, ces formes de gouvernance démocratique ne sont pas similaires dans tous les pays ni chez tous les peuples. Ceci se conçoit fort bien puisque le continent africain est très vaste (plus 30 millions de kilomètres carrés) et il compte des milliers de peuples différents, un grand nombre d’ethnies indéfinies.
Donc, cette figure de démocratie obéit aux formes et aux structures mises en place par des systèmes politiques qui sont eux-mêmes très variés. Malgré cette diversité dans les formes de la gouvernance, les traits constants et généraux résident dans la solidarité qui se traduit par des « dons et contre-dons » (p.80), voire par un large partage du pouvoir et de sa limitation ; surtout, par ce qu’on pourrait appeler le système « autogestionnaire » de chaque peuple ou ethnie dans le sens de l’intérêt de tous et de chacun.
C’est en ce sens que l’auteur écrit : « La gestion du bien commun existait en Afrique… sous le vocable du forobà (en langue dioula), qui représente la conception africaine de « la chose publique » (re publica). La démocratie de base existait sous le couvert de structures villageoises avec la représentation des différentes familles. Celles-ci se réunissaient régulièrement soit à travers le groupe des dirigeants de ces familles – les aînés ou les doyens – afin de discuter tous les problèmes concernant le village, soit sous le couvert d’une chefferie importante ou d’un royaume. Toutefois, à la base, il y avait toujours cette autonomie paysanne et villageoise. Elle était le fondement le plus caractéristique de l’autogestion africaine.
Au niveau supérieur, les chefs et les rois étaient entourés par des conseils d’anciens, représentants les différents clans ou les différentes ethnies présentes dans le village ou la ville » (p.80). Puisque, selon Ki-Zerbo, l’Africain est, par une inclination naturelle, un être social, dans l’espace public réservé aux débats des problèmes communs, par exemple, recevoir et céder un terrain à un étranger, chacun était invité à donner son avis sur une telle opportunité. Dans ce genre d’affaire qui engage toute la communauté, l’avis des femmes importait également. Pour que la décision prise respecte le principe du consensus, les anciens devaient prendre la parole en dernier, c’est-à-dire après avoir écouté les arguments des uns et des autres.
En cas de désaccord, l’objet des débats était renvoyé à une date ultérieure. C’est cette manière de débattre qui a conduit les Européens, en particulier le Français, à qualifier péjorativement ce mode d’accès à un accord consensuel en l’étiquetant de « palabre africaine ». Car elle pouvait durer des jours, des semaines, voire des mois, éventuellement parce que le principe sous-jacent à tout cela était de parvenir à un « consensus maximal ».
Ainsi, l’exercice du pouvoir traditionnel n’avait rien à voir avec l’appropriation personnelle de la puissance publique comme on le constate dans les fameux régimes démocratiques d’aujourd’hui. Car dans l’exercice de son pouvoir, le roi n’était jamais seul. Il était toujours entouré par des conseillers avisés et de divers types de pouvoirs partiels ou occultes. Ainsi en était-il des royaumes yoruba du Benin : les grands conseillers avaient le pouvoir de sanctionner leur roi s’il enfreignait les lois du royaume. On lui signifiait qu’il n’était pas au-dessus des lois. S’il se conduisait de manière « autocratique, ils lui envoyaient des œufs de perruche pour lui donner l’ordre de se suicider » (p.85).
Joseph Ki-Zerbo donne un autre exemple typique de la démocratie telle qu’elle fonctionnait dans l’exercice du pouvoir politique traditionnel et qui n’a strictement rien à voir avec les formes de démocratie issues des fameuses indépendances. Certes, en vertu des rituels d’investiture d’un chef ou d’un roi autochtone, celui-ci pourrait être considéré comme un être au-dessus des autres. Il n’en est rien dans les faits. Car d’autres rituels lui rappellent, lors de son investiture, qu’il est un être comme tout autre sujet humain, c’est-à-dire ses sujets. Il a, certes, des droits, mais surtout des devoirs vis-à-vis de son peuple.
En effet, il en est le premier responsable. C’est le cas de certaines figures de chefferie chez les Mossi comme l’écrit Joseph Ki-Zerbo : « Chez les Mossi, le candidat à la chefferie se présentait dans le plus simple appareil avant qu’il ne soit désigné ou investi. Il portait un petit pantalon, avait le buste nu et son corps couvert d’une peau de mouton. Cela signifiait qu’au départ le roi était dépouillé de tout ; il arrivait sans rien au pouvoir et devait se comporter sans s’enrichir sur le dos de ses sujets. Le roi devait être soumis aux devoirs et aux contraintes de son nouvel état ; ses obligations lui étaient rappelées à chaque grande cérémonie ou « salutation » » (p. 85).
Les grands royaumes et les empires comportaient une organisation sophistiquée à la fois horizontale et verticale. Elle dépassait en finesse et en rigueur les fameuses décentralisations de l’Administration contemporaine. La limite de celle-ci tient au fait qu’étant une copie de ce qui marche le mieux possible dans les pays européens, telle que la France et, donc, étrangère aux modalités de fonctionnement locales, ces décentralisations semblent très souvent bancales, boiteuses et mal adaptées, mal appliquées parce que leurs règles de fonctionnement n’ont pas été bien comprises ni même maîtrisées. Ainsi, au lieu d’être un facteur de progrès, elles se transforment souvent en un réel handicap majeur et en une bureaucratie encombrante pour la bonne marche de l’Administration.
Contrairement à un tel état de fait aujourd’hui, Ki-Zerbo donne, sur ce point, l’exemple de l’empire du Mali qui a eu beaucoup de grands rois qui ont fait preuve de conduites différentes, de caractère également. Toutefois, le système de gouvernance ne variait pas sur le fond, à savoir la distribution du pouvoir la plus large possible en vue de responsabiliser toutes les parties prenantes dans la gestion des affaires publiques.
Ainsi, écrit-il, « Dans les cantons appelés Kafou, il y avait un système de gouvernement autonome ou tributaire d’une principauté supérieure. Certaines petites royautés relevaient directement de l’empereur lui-même avec toute une série de fonctionnaires strictement organisés et la fiscalité bien structurée d’un État de type moderne » (p. 88). En ce sens, l’organisation territoriale de l’empire du Mali, voire sa stabilité séculaire jusqu’à l’arrivée des Arabes et des Européens par après, peut être considérée comme une coordination aussi sophistiquée et rationnelle que celles d’autres grandes civilisations d’Europe ou d’Asie.
D’autant plus, en tant qu’État de droit, l’empire concédait la liberté et l’autonomie culturelle à toutes les ethnies ou peuples qu’il comprenait en son sein. C’est pourquoi Ki-Zerbo reconnaît que « L’empire malien est véritablement caractéristique de ce que les Africains ont fait de mieux en matière de structuration territoriale, juridique, politique et culturelle en Afrique de l’Ouest pour marier le pouvoir central avec les exigences de type fédéral et l’autonomie des bases et des marges » (p.90).
En somme, le plaidoyer de Joseph Ki-Zerbo, si plaidoyer il y a, consiste à prouver que les peuples africains n’ont pas attendu l’occupation des Européens pour s’organiser rationnellement sur le plan politique. Mieux, certains empires comme le Mali, Gao, Ghana, etc., faisaient preuve d’une complexité étatique sophistiquée dès le Moyen-âge, c’est-à-dire avant même l’émergence des royaumes de certains États européens. Le royaume du Dahomey, invincible pendant près de 500 ans avant sa chute face aux Français en 1895 – victoire rapportée contre les redoutables Amazones du roi Béhanzin grâce à la complicité de troupes africaines comme Ouidah, les Spahis du Sénégal et des troupes militaires du Gabon – faisait aussi preuve d’une stabilité remarquable.
En revanche, l’occupation européenne des territoires africains a entraîné durablement deux types de désordre : 1) la colonisation, au sens que j’ai souligné ci-dessus, (influence culturelle) des esprits pour une occupation durable ; 2) l’instabilité, voire la « manufacturation », selon le mot de Robert Jaulin (La paix blanche, tome 1, UGE, Paris 1974) des systèmes politiques, soit la manière spécifique des intellectuels africains de changer étrangement les choses en fonction de leur mentalité d’acculturés, notamment dans les pays dits indépendants de la zone francophone de l’Afrique subsaharienne.
II- L’avatar de la démocratie en Afrique subsaharienne : ses excès et ses trahisons des peuples par rapport aux engagements des élites politiques
Certes, et ceci est bien répandu partout : les Africains subsahariens, en tant qu’ils sont issus de l’oralité , sont vite oublieux de leur passé – on dit qu’ils sont généralement peu portés à la lecture - ; même le plus proche des contemporains. C’est pourquoi je vais commencer par cette citation de Jacques Chirac, ancien chef d’État français dit « ami des Africains », qui démontre, de manière manifeste, les ambiguïtés, les manipulations et les désordres dans les régimes politiques des pays africains subsahariens, notamment la zone francophone. En 1990, il était alors dans l’opposition. Il fit un voyage officiel à son mentor Félix Houphouët-Boigny, qui avait largement financé sa campagne électorale des législatives.
Interrogé par RFI, Chirac, comme pour complaire à son mentor ivoirien, n’hésite pas à affirmer : « Le multipartisme n’est pas lié à la démocratie et il y a des pays africains parfaitement démocrates, comme la Côte d’Ivoire, qui sont des pays à parti unique et où la démocratie s’exerce au sein de ce parti unique » . Le futur chef d’État français d’alors en rajoute une couche dans le mépris : « Le multipartisme est une sorte de luxe que ces pays en voie de développement n’ont pas les moyens de s’offrir ». Tout compte fait, selon Jacques Chirac, les Africains ne sont « pas mûrs pour la démocratie ».
Le pire tient au fait que les Africains n’ont pas pu ou su imaginer, créer ou inventer une autre figure de gouvernance ou de l’exercice de la démocratie et du respect rigoureux de ses règles fondamentales propres de fonctionnement. Pire encore, aucun de ceux qu’on appelle ordinairement les « intellectuels africains » n’avait osé protester contre une telle aberration d’une élite politiques française ; une affirmation si générale, les « Africains » et sans nuance aucune qu’elle semblait n’être autre chose qu’un pur préjugé, voire le mépris de tout un continent et de ses habitants.
On remarquera qu’aucune élite politique française ne parle en ces termes s’agissant des pays de l’Asie, de l’Amérique du Sud et Centrale, de l’Europe de l’Est dont les conditions de certaines populations d’entre les pays de cette zone ne surpassent pas celles des populations de l’Afrique noire ; ni même des pays du Maghreb. Comme Ki-Zerbo l’a si bien écrit dans son ouvrage Éducation et développement en Afrique – Cinquante ans de réflexion et d’action (Les Presses Africaines, Ouagadougou, 2010), l’Afrique noire est comme un « baudet » que tout le monde frappe impunément. Et c’est le cas.
Selon Joseph Ki-Zerbo, la césure entre la période antéoccupation (pouvoirs politiques autochtones) et post-occupation (les fameuses indépendances) se tient dans le fait majeur suivant. En effet, dès les premières gouvernances, hormis l’immixtion des puissances de tutelle européennes, les élites de l’Afrique noire se sont adonnées au népotisme et à la corruption généralisée.
Or la corruption est une plaie purulente inique en soi : les uns jouissent abondamment des biens de l’État ; quant aux autres, ils n’ont plus que leurs yeux pour pleurer puisqu’ils sont rejetés de la sphère des richesses de leur pays. Elle n’est pas non plus une voie saine pour un réel développement d’un pays. Dès lors, la direction des États africains, étant ainsi dévoyée, viciée, les élites politiques africaines n’ont jamais été en mesure d’assumer adéquatement leur responsabilité par rapport aux intérêts généraux et particuliers de leurs peuples.
Et l’on comprend tout à fait qu’il n’ait jamais été question de bonne gouvernance. Ki-Zerbo souligne, ainsi, comment l’exécutif, soit le pouvoir réel, à la tête des pays de l’Afrique noire a manqué de respecter ses devoirs fondamentaux à la fois vis-à-vis des pouvoirs politiques traditionnels, qu’il a méprisés dès le départ, voire rejetés, et des peuples de ces pays dits indépendants. Les hommes politiques se sont emparés, (appropriés même) du pouvoir exécutif en écrasant les autres figures qui fondent la démocratie, comme le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, l’alternance des partis politiques à la tête de l’État.
La longue citation ci-dessous pose le tableau des trahisons des élites politiques de l’Afrique noire par rapport aux attentes et aux besoins de leurs peuples respectifs. A ce sujet, Joseph Ki-Zerbo écrit en effet : « Ce qui est caractéristique actuellement chez les dirigeants africains, c’est que l’idée d’avoir à rendre compte à des instances – une idée qui était très forte pendant la période pré coloniale et au temps colonial – a souvent disparu. Dans ce cas, ces élites sont légales, la plupart du temps, parce qu’elles fonctionnent en conformité avec les lois, mais elles ne sont pas légitimes. Selon moi, une élite devrait être au-dessus du commun des gens du point de vue juridique, mais aussi au plan éthique et moral qui fonde la légitimité.
Toutes ces qualités manquent à bon nombre de nos dirigeants africains d’aujourd’hui ; dans ce cas, les dirigeants africains arrivent au pouvoir alors qu’ils sont loin d’être fortunés. Ils se servent du pouvoir pour accumuler des biens de toutes sortes – par une mainmise sur les terrains et terroirs, par des opérations frauduleuses à l’occasion de l’attribution des marchés publics, par la récupération de commissions importantes, il y a mille manières de s’enrichir. Une complicité plus ou moins mafieuse s’établit aussi entre les dirigeants politiques et les opérateurs économiques.
C’est au niveau de la famille des dirigeants politiques et de leurs proches en tant que prêtes noms que les avoirs économiques sont accumulés » (p.p.85-86). C’est dire si les élites politiques de ces pays pensent d’abord au remplissement de leur ventre. Quant aux intérêts légitimes de « la chose publique », ce n’est guère leurs soucis. C’est en ce sens que l’adage consacré de la vie quotidienne dit quelque chose de vrai : « Les Africains sont en apparence, mais en apparence seulement, solidaires. Mais, au fond, l’égoïsme voilé domine partout ».
Cette réalité est tellement manifeste au niveau des États africains subsahariens qu’il n’y a personne qui oserait la contester ; à moins de faire preuve d’une mauvaise foi évidente. Si l’on s’avise de chercher l’exercice normal de la démocratie dans ce genre de gouvernance étatique, en Afrique subsaharienne, on perdrait son temps. Car à vrai dire, il n’y en a nullement part.
Or si la démocratie se définit, selon Joseph Ki-Zerbo, comme « le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple » (103), on comprend que le penseur se soit heurté aux pouvoirs exécutifs en place en Haute Volta, puis au Burkina Faso. Il s’agit de toutes sortes de difficultés intellectuelle et politiques, des menaces physiques sur sa personne qu’on pourrait qualifier comme des déboires, voire des désillusions de ne pas pouvoir servir les intérêts de son pays pour lesquels, il avait dû renoncer à une carrière universitaire internationale.
D’abord, en tant que défenseur d’une démocratie participative, qui consiste à donner plus de pouvoir, d’autonomie aux milieux populaires, notamment aux paysans, une telle volonté de rénovation politique n’était pas recevable de la part de la classe politique en place. Car le multipartisme se réduisait à une façade peu respectueuse des principes fondamentaux de la démocratie. En somme, c’était ni plus ni moins qu’une mascarade.
C’est d’ailleurs, cet aspect de l’exercice politique qui décourage le réel militantisme des jeunes. A quoi bon militer ou voter s’il s’agit de maintenir en place les mêmes gens qui causent, d’ailleurs, des dégâts par rapport à la bonne marche des affaires du pays ? Les détenteurs du pouvoir exécutif qualifient leur forme de gouvernance de système présidentiel. Cette posture mentale, traduite dans les faits, signifie que le parlement (ni même l’appareil judiciaire) n’est pas pris en compte.
Quand bien même on concède son existence (le parlement), ce n’est rien d‘autre qu’un pouvoir de seconde zone. Pourtant, les parlementaires, élus du peuple, sont censés lui être plus proches, être à son écoute, c’est-à-dire attentifs à l’expression de ses besoins, à ses doléances en vue de les porter au niveau du pouvoir exécutif. Or dans le système présidentiel, dès lors que l’exécutif n’accorde pas beaucoup de place à l’opposition, très vite s’installe un régime politique à parti unique comme Ki-Zerbo en avait lui-même fait l’amère expérience durant les périodes de ses engagements et de sa participation à la vie politique de son pays.
C’est ce sens qu’il écrit : « Au Burkina Faso, par exemple, pendant la deuxième législative (1997-2002), le parlement était dominé par un parti unique de fait qui totalise 103 sur 111 députés. Dans ces conditions, les députés n’ont pas de ligne, ils appartiennent pratiquement au parti du président Blaise Compaoré. Et comme le parti n’a presque pas de ligne non plus, le pouvoir se « monarchise » de plus en plus. Il y a donc un processus négatif : au lieu d’avoir un multipartisme qui assure l’expression plurielle de la volonté politique du peuple, il y a un monopartisme de fait » (p.100).
Dans ces pays de l’Afrique subsaharienne au système présidentiel, il ne peut pas y avoir d’opposition effective pour les raisons suivantes. D’une part, les partis d’opposition, faute de moyens matériels et financiers, ne sont pas en mesure de mener des campagnes législatives au même niveau que le parti du pouvoir exécutif. D’un côté, c’est la misère financière, c’est le manque de moyens matériels pour parcourir tout le pays et faire campagne.
De l’autre côté, on assiste à un excès de moyens financiers et matériels puisque le chef de l’État use abondamment de l’argent public, soit les impôts des contribuables et la production des richesses du pays pour arroser largement son parti. D’autre part, cette grande différence de niveau de moyens conduit le parti au pouvoir à la corruption des consciences par une distribution massive d’argent et de nourriture aux éventuels électeurs. On achète, ainsi, leur conscience de citoyens libres (mais, est-on libre quand on est affamé ?) et on leur ôte leur autonomie de jugement, voire l’exercice normal de leur pensée politique, si pensée il y a.
Ce système pervers, puis les dons pernicieux aux autorités traditionnelles (chefs, rois, princes, etc.) pour les encourager à appeler les villageois à voter pour le parti du président, sans oublier le nécessaire bourrage des urnes a eu pour effet immédiat de laminer les candidats des partis d’opposition. C’est en ce sens que Jacques Chirac a eu, sans doute, raison d’affirmer que les pays en voie de développement ne peuvent pas se payer « le luxe » d’instituer la démocratie et de la respecter rigoureusement. C’est ce qui fait que les électeurs des pays de l’Afrique subsaharienne sont voués à la servitude et non à l’autonomie de leur conscience, notamment politique.
Enfin, de nombreux partis dits d’opposition sont des partis fantoches, souvent créés par le parti du président et la finalité, après les élections législatives, consiste à se fondre dans le parti au pouvoir pour participer au gouvernement ; quitte à y perdre leur identité. Ce n’est donc pas, au sens absolu du terme, de la démocratie dont il s’agit, ici, mais bien de la « mangécratie », selon le beau terme d’Issiaka Diakité-Kaba.
Donc, les partis politiques deviennent des échoppes de commerce, une sorte de métier fictif permettant de vivre à l’aise sur le dos de l’argent des contribuables . Alors, ces partis politiques fantômes sont progressivement démantelés par la nomination de leurs chefs à des postes de ministres, comme si telle était leur ultime but dans la création de leurs partis. Tel était l’art consommé de la manipulation politique de Blaise Compaoré, selon Joseph Ki-Zerbo.
C’est pourquoi le parti politique créé par Joseph Ki-Zerbo n’a pas vraiment trouvé sa place ni sous Maurice Yaméogo ni sous Blaise Compaoré. Car « Maurice Yaméogo, le premier président après l’indépendance… avait été placé à la tête de la Haute Volta par les autorités françaises » (p.151) pour exécuter leurs ordres, suivre leurs diktats. Quant à Blaise Compaoré, il voulait se maintenir au pouvoir coûte que coûte en s’inspirant du système présidentiel de Félix Houphouët-Boigny et ses nombreux crimes politiques, comme Ahmadou Kourouma, véritable anthropologue des réalités des peuples noirs dans l’ensemble de ses romans, fine et perspicace intelligence au service du dévoilement des arrières- mondes sordides de certains chefs d’État de l’Afrique noire, l’a bien démontré dans son livre En attendant le vote des bêtes sauvages (Éditions du Seuil, Paris 1998).
La preuve : Blaise Compaoré n’a pas hésité, lui aussi, à commettre des crimes d’État comme l’assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons le 13 décembre 1998. Aussi, le parti de Ki-Zerbo ou, plutôt, son « Mouvement de libération nationale » (MLN), qui était panafricain, ne pouvait nullement s’accorder avec la gouvernance des pantins mis en place par la puissance de tutelle, en l’occurrence, la France. Car les principes et les finalités de celui-ci étaient jugés dangereux ou subversifs par cette puissance de tutelle et ses fantoches au pouvoir dans son pays.
Quel était le programme, d’ailleurs, du « Mouvement pour la libération nationale » (nationale relativement à chaque pays de l’Afrique subsaharienne) ? C’est l’auteur lui-même qui les énonce ainsi : « Il était pour l’indépendance par rapport aux pouvoirs étrangers, l’unité africaine et un socialisme refondé sur les réalités, les intérêts et les valeurs de l’Afrique. Ce programme indépendantiste, anticolonial et antinéocolonial, progressiste aussi, visait à transformer l’Afrique. Nous voulions la faire vivre sur ses racines afin de donner une version moderne à l’Africanité et une version africanisée de la modernité grâce au développement endogène. Je crois que cette ligne politique est difficilement compatible avec le type de régimes que nous avons eu successivement en Haute Volta d’abord et ensuite au Burkina Faso » (p. 151).
Avec l’avènement de Thomas Sankara et l’instauration de la révolution au Burkina Faso à partir de 1982-1983, les rapports entre les deux grandes figures emblématiques de cette époque n’ont pas été simples. Même si certaines options de Sankara n’étaient pas contraires à sa philosophie politique, Joseph Ki-Zerbo pensait que les principes fondamentaux de son « Mouvement pour la libération nationale » ne pouvaient pas trouver une place adéquate au sein de cette jeune révolution.
En outre, leurs liens personnels étaient ambigus comme l’explique Joseph Ki-Zerbo lui-même : « En fait, je n’ai pas tellement connu Thomas Sankara, je l’ai rencontré une fois pendant une heure à peu près. C’était à mon retour au pays, après la prise de pouvoir le 4 août 1983. Au lendemain de mon arrivée, j’ai été mis en résidence surveillée. J’ai donc pris l’initiative de le rencontrer. La réponse a tardé. Probablement, cela reflétait les différences d’attitude à mon égard. La rencontre a finalement eu lieu au Conseil de l’Entente, en présence du chef de la gendarmerie. J’ai été frappé par la liberté de ses propos.
Cela a été un échange assez franc et direct qui consistait à expliquer pourquoi ils avaient fait leur coup : « Nous avons pris le pouvoir parce qu’il s’agissait de libérer notre peuple », disait Sankara » (p.p.154-155). A la suite de cette rencontre, Joseph Ki-Zerbo a tenté, mais en vain de le rencontrer à nouveau pour clarifier la situation entre eux. Puis, l’on a lancé des attaques publiques contre lui sans raisons apparentes ni aucune justification. Alors, il dût s’exiler de nouveau.
Par la suite, c’est-à-dire après son exil, ce fut Thomas Sankara lui-même qui, par l’intermédiaire de diverses personnalités, tenta à trois reprises de le contacter. Il lui disait notamment : « Il faudrait revenir. C’est votre pays, il a besoin de vous ». J’ai répondu que, sur le principe, il n’y avait pas de problème, mais pas dans l’immédiat. Cela exigerait un peu de temps ».
Il n’en demeure pas moins que, par rapport à la personne de Thomas Sankara, Joseph Ki-Zerbo avait de l’admiration pour lui en vertu des raisons fondamentales qui expliquaient son engagement total dans la défense des intérêts majeurs du peuple burkinabè ; même s’il savait, d’un point de vue intellectuel et d’historien, que sa révolution était un modèle précurseur d’une autre possible donnée politique et, qui, à cette époque, était vouée à l’échec en raison de l’hostilité de la puissance de tutelle et des autres chefs d’État africains complices. C’est en ce sens qu’il écrit : « Sankara était un patriote sincère et déterminé, un idéaliste volontariste. Toutefois, « il n’a jamais réalisé assez tôt que les conditions objectives de la révolution n’étaient pas réunies. De plus, le contexte s’opposait à la réalisation de son programme » (p.155) politique.
III- Un projet pour l’Afrique ?
Les paradoxes des pays de l’Afrique noire sont multiples relativement au concept de développement économique. Je les ai amplement analysés dans un essai de géopolitique . Même sur ce point, il y a un abandon total des valeurs traditionnelles. A titre d’exemple, les riches des cultures autochtones n’étaient pas des individus qui se plaisaient à faire de la monstration de leurs richesses ou de leurs biens qu’ils avaient, d’ailleurs, acquis par leur propre travail. Leurs richesses consistaient essentiellement dans l’acquisition d’un certain nombre de têtes de bétails, voire dans le fait que leurs greniers étaient pleins de mil pouvant suffire à nourrit largement les membres de leurs familles.
Toutefois, un riche ne pouvait pas être égoïste : dès que se posait un problème à la famille, voire au niveau du clan, il donnait des bêtes nécessaires pour résoudre le problème en question. C’est pourquoi la valeur traditionnelle essentielle que les Africains des indépendances ont perdue ou presque, c’est le sens de la Solidarité. A la place de celle-ci, ils ont acquis l’égoïsme et l’ont mis à la place de cette dernière.
En effet, dans les cultures autochtones, on ne voyait point de mendiants sur la place publique, encore moins dans les villages. Les terres étant riches et la démographie contrôlée, tous les individus à l’âge de travailler atteignaient le niveau d’autarcie. En revanche, dans l’Afrique des indépendances, l’on s’est mis à imaginer que le développement signifie l’acquisition de biens matériels qu’on se plaît à montrer de manière ostentatoire. Certes, c’est bien le modèle des pays européens ou asiatiques.
Donc, l’on n’a pas songé à penser une société africaine nouvelle ayant une forme de développement authentique, c’est-à-dire fondée sur les valeurs de solidarité des sociétés traditionnelles que Joseph Ki-Zerbo appelle le « développement endogène », soit un développement qui provient de l’intérieur de ces sociétés. Il est différent des modèles importés et mal compris ou mal adaptés aux données des peuples africains. Or, dans le cadre des formes de développement, l’on s’est contenté de se saisir du mot développement sans l’interroger ni en comprendre le sens effectif.
C’est pourquoi et, de manière générale, en Afrique noire, le développement, au niveau des particuliers, signifie avoir une belle voiture, une belle maison, une richesse ostentatoire pour éblouir autrui, comme l’argent liquide qui coule à flot quand il s’agit d’épater son entourage ou ses amis et connaissances. Après tout, pourquoi pas ? Il n’est pas interdit de s’enrichir s’il s’agit de biens acquis honnêtement, c’est-à-dire par ses propres efforts et par son travail.
C’est le contraire même de la facilité : acquérir des biens matériels, s’enrichir par des moyens frauduleux, occultes ou non. Cependant, si l’on pense que c’est cela le développement, alors que son pays est pauvre et crie misère, c’est-à-dire le niveau général des conditions de vie de sa population est très bas, eh bien, on se trompe. D’ailleurs, c’est ce genre de soi-disant développement que des économistes contemporains de gauche appellent « l’anti-développement », le « faux développement ».
C’est cette situation, plutôt déshonorant, que Joseph Ki-Zerbo décrit ainsi : « On sait que les pays du Sud ne pourront jamais rattraper les pays industrialisés. Pourtant, on continue à dire : « Rattrapez-nous ! Faites comme nous ! » Je prends le cas du Burkina Faso aujourd’hui. On y voit des scènes incroyables : bien que ce pays figure parmi les plus pauvres du monde, il y a des embouteillages de Mercédès à longueur de journée. Pendant ce temps, des gens meurent de faim et de toutes sortes de maladies. Il est vrai que le surcroît de pneumopathies à Ouagadougou a quelque chose à voir avec l’accroissement de pollution entraînée par l’extension des marchés d’occasion de l’Europe en Afrique (véhicules, médicaments, friperies, armes, etc.) Cela montre que ce qu’on appelle le développement doit être revu et corrigé. Sinon, c’est non seulement une supercherie, mais une escroquerie. Heureusement que la majorité des populations africaines ne comprend pas ce qui se passe ! Sinon, il y aurait des jacqueries en permanence. Les limites de l’absurde et son caractère structurel entraineraient des explosions en série » (p.179).
Puisque les pays africains se sont hâtés d’embrasser un phénomène qu’on appelle « le développement » sans en avoir suffisamment analysé son sens, son but, ses finalités pour soi-même, je veux dire pour les peuples africains – il faut dire que pour tous les pays de l’Afrique noire, il s’agit d’une démarche pragmatique et empirique -, Joseph Ki-Zerbo propose un projet à trois échelles ou, comme il le dit lui-même : « une fusée à trois étages : les biens économiques, les biens sociaux (comprenant les relations humaines, les services et l’organisation humaine) et les valeurs ».
Il précise davantage quelle est la nature d’une telle réorganisation authentiquement africaine. « Ce projet humain ne vise pas simplement à maximaliser la consommation matérielle. Il se construira sur la base des valeurs de la solidarité, de la convivialité, de l’altérité, de la compassion, du contrôle de soi, de la pitié et de l’équilibre inspiré de la Maât pharaonique » (p. 207).
D’abord, d’un point de vue économique, Joseph Ki-Zerbo part du principe qu’en vertu de l’émiettement des territoires africains (Afrique noire) à la Conférence de Berlin du 15 nov. 1884 – 26 févr. 1885 par les puissances occidentales, les Africains de la période postindépendance doivent envisager l’avenir de leur continent dans le cadre d’une intégration économique fondée sur le principe d’une économie complémentaire .
Mieux encore, cette intégration continentale doit se concevoir à tous les niveaux, c’est-à-dire : l’éducation (recherches de nouvelles pédagogies au niveau continental), recherches scientifiques, modèles d’industrialisation endogène, c’est-à-dire qui refuse le concept de concurrence généralement impitoyable et rivalité avec les pays occidentaux, les pays de l’Asie du Sud-Est. Il s’agit de produire pour satisfaire les besoins des consommateurs africains. Ki-Zerbo pense que la démocratie constitue l’un des volets majeurs d’un tel développement. Toutefois, la limite sur ce point tient au fait que les Africains doivent inventer eux-mêmes une autre forme propre de démocratie.
Car ils se montrent réfractaires au respect des principes fondamentaux de la démocratie à l’Occidentale. Il me semble, donc, que pour le moment, en reprenant le mot de Jacques Chirac, la démocratie paraît comme un « luxe » inapplicable ou difficilement applicable pour des pays qui sont toujours en quête d’une forme de gouvernance adaptée aux mentalités « manufacturées » par l’influence des pays du Nord et par leur forte prégnance sur les mentalités contemporaines.
C’est pourquoi, reconnaît Joseph Ki-Zerbo, les pays africains, qui s’en tiennent toujours à leurs principes de fonctionnement général, qui sont toujours debout sur leurs propres pieds, ne sont pas en mesure de parler réellement « d’égal à égal avec les géants du monde » (p.191). Une éventualité, si elle advenait quelque jour prochain, ne peut s’accomplir que par la volonté éclairée de tous les Africains à réaliser « l’union africaine » (p.203) réellement fondée sur l’idée neuve du développement économique pour tous les peuples d’un pays et du progrès des lumières au niveau des esprits.
Toutefois et, à cet effet, il y a une condition principale que les pays ou les peuples africains doivent réaliser : à savoir de grands ensembles économiques et industriels, mais à la seule condition que ce ne soit pas des structures à la coquille vide comme Félix Houphouët-Boigny avait inventée, en l’occurrence, le Conseil de l’Entente . En fait et comme le souligne Joseph Ki-Zerbo, le développement de l’Afrique, à l’échelle continentale devra s’opérer dans le cadre de l’Union d’un certain nombre de pays qui s’accordent sur les principes fondamentaux de développement de leur structure unifiée.
« Je suis convaincu qu’on ne peut réaliser le développement dans le cadre de petits pays ; le développement endogène sera interafricain ou ne le sera pas. Et l’ouverture au monde, qui n’est pas une fin en soi, ne sera positive qu’à travers les structures régionales seules capables de faire de l’Afrique une force parmi les forces du monde. En effet, l’ouverture béate et béante actuelle qui prévaut depuis des siècles ne nous ont pas fait avancer substantiellement ». Donc, « l’Afrique doit se constituer avant de descendre sur le terrain du jeu, dans l’arène même et surtout si c’est pour délivrer un message de paix » (p.204).
Dans cette perspective, une pensée globale philosophique, économique, politique, etc., est nécessaire pour insuffler la dynamique et le sens à l’action dans tous les pays. J’ai déjà souligné que l’Afrique ne peut faire l’économie d’une philosophie générale qui embrasse tous les aspects des réalités sociales, culturelles qui lui sont propres. Il est vrai : la philosophie ne nous confère pas l’omniscience, puissance qui appartient à Dieu seul.
L’entendement humain est trop borné pour disposer d’une telle immense faculté. En revanche, la philosophie nous donne des outils conceptuels pour comprendre l’ensemble des sciences qui sont toutes issues, sans exception, de son fonds propre. Concernant la vision du monde édifiée par les philosophes européens du XVII-XVIIIe siècle (et même avant les temps modernes) que le monde entier a en partage, qu’il la comprenne ou non, quelques exemples suffisent à saisir le sens mon insistance sur la nécessité d’une philosophie pour l’Afrique.
La science moderne et contemporaine est née de la pensée de Kepler, Copernic, Galilée, Bruno Giordano, Pascal, Descartes, Newton au XVI-XVIIè siècle. Ils sont tous des philosophes. En économie, c’est le philosophe Britannique Adam Smith (Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, tome I et II) qui, à la suite d’Aristote (Les économiques), a donné à l’économie son caractère scientifique et sa portée rationnelle. Jusqu’à nos jours, la suite des penseurs en économie ont repris, à divers niveaux et sous des angles différents, sa philosophie économique et politique.
En matière de philosophie politique justement, ils sont nombreux les philosophes qui ont inspiré l’action politique à l’Europe moderne et contemporaine. Il s’agit de Thomas Hobbes (Léviathan), de John Locke (Traité du gouvernement civil, en deux parties) en Grande Bretagne, de Montesquieu (De l’esprit des lois), de Jean-Jean-Jacques Rousseau (Du contrat social), etc., en France, d’Emmanuel Kant (Vers la paix perpétuelle) en Allemagne, etc.
Le XIXe a été marqué par l’explosion de nouvelles sciences comme la psychologie-psychanalyse (Sigmund Freud), la sociologie (Auguste Comte), et toutes les autres sciences connues aujourd’hui sont fondées par des philosophes qui ont pris leur autonomie par rapport à la régence permanente des Savoirs et des Sciences par la raison philosophique depuis le IVe siècle avant J.-C. C’est ce qui explique qu’aux Etats-Unis d’Amérique, les futurs scientifiques, pendant leurs cursus universitaires, font parallèlement des études de philosophie (doctorat) pour acquérir de l’aisance dans les champs des théories scientifiques.
Tout compte fait, ce sont, donc, des penseurs qui ont fait défaut à l’Afrique noire pour lui ouvrir les yeux sur l’univers éthéré des lumières de la raison en tant qu’esprits éclairés par la puissance de la vision philosophique ou de la raison théorique. Cependant, comme le souligne Ki-Zerbo, « la pensée ne doit jamais être séparée de l’action et réciproquement » (p.206).
Enfin, quant à la deuxième échelle, celle des « liens sociaux », il n’y a pas lieu, ici, de se livrer à des analyses pour expliquer ce qui, chez les peuples africains, constitue les fondements de leur modalité d’existence. Ce sont des sociétés de solidarité consubstantielle, en particulier au niveau des cultures et des sociétés autochtones. Le dernier niveau de la fusée concerne les « valeurs ».
Il s’agit de la philosophique éthique de Joseph Ki-Zerbo. C’est un idéal d’humanisme, c’est-à-dire le fait de se conduire en être humain par rapport à autrui. C’est ce qu’il appelle « l’humanitude » (p.208). Ce serait, si une telle éthique se réalisait dans les faits, la touche typiquement africaine qui serait apportée au genre humain. En d’autres termes, il s’agit d’un bel idéal à construire et à vivre ensemble.
PIERRE BAMONY
(Philosophie, Anthropologie, Science)
Bibliographie
![]() Bamony Pierre : Pourquoi l’Afrique si riche est pourtant si pauvre ? - De la faillite des élites de l’Afrique subsaharienne - tome 1(Éditions Le Manuscrit, Paris 2010, 449 p)
Bamony Pierre : Pourquoi l’Afrique si riche est pourtant si pauvre ? - De la faillite des élites de l’Afrique subsaharienne - tome 1(Éditions Le Manuscrit, Paris 2010, 449 p)
![]() Pourquoi l’Afrique si riche est pourtant si pauvre ? - Tome 2 La Malédiction du pouvoir politique. Quel espoir des peuples de demain ? (Éditions Le Manuscrit, Paris, 2011)
Pourquoi l’Afrique si riche est pourtant si pauvre ? - Tome 2 La Malédiction du pouvoir politique. Quel espoir des peuples de demain ? (Éditions Le Manuscrit, Paris, 2011)
![]() LA RÉALITÉ DÉVOILÉE DES CAUSES DE L’ÉCHEC ECONOMIQUE DES PAYS AFRICAINS -ESSAI DE GÉOPOLITIQUE- Tome I (KDP/Amazon, Mai 2021)
LA RÉALITÉ DÉVOILÉE DES CAUSES DE L’ÉCHEC ECONOMIQUE DES PAYS AFRICAINS -ESSAI DE GÉOPOLITIQUE- Tome I (KDP/Amazon, Mai 2021)
La malédiction du pouvoir politique - Quel avenir pour les peuples de l’Afrique noire ? – Essai de géopolitique (Tome II) (KDP/Amazon, Mai 2021)
![]() L’HORRIQUE DU GENRE H. - Jugement dernier et extermination de l’espèce humaine (Éditions du Net, Paris septembre 2023)
L’HORRIQUE DU GENRE H. - Jugement dernier et extermination de l’espèce humaine (Éditions du Net, Paris septembre 2023)
![]() Diakité-Kaba Issiaka : Sisyphe… l’Africain (L’Harmattan, Paris)
Diakité-Kaba Issiaka : Sisyphe… l’Africain (L’Harmattan, Paris)
![]() Geoffroy A. Dominique Botiyiyé (2010) : Le passage à l’écriture – Mutation culturelle et devenir de savoirs dans une société de l’oralité – (Presses universitaire de Rennes, coll. « Le Sens social », Rennes)
Geoffroy A. Dominique Botiyiyé (2010) : Le passage à l’écriture – Mutation culturelle et devenir de savoirs dans une société de l’oralité – (Presses universitaire de Rennes, coll. « Le Sens social », Rennes)
![]() Jaulin Robert : La paix blanche, tome 1 (UGE, Paris 1974)
Jaulin Robert : La paix blanche, tome 1 (UGE, Paris 1974)
![]() Ki-Zerbo : A quand l’Afrique – Entretien avec René Holenstein- (Éditions d’en-bas, Lausanne 2013)
Ki-Zerbo : A quand l’Afrique – Entretien avec René Holenstein- (Éditions d’en-bas, Lausanne 2013)
Éducation et développement en Afrique – Cinquante ans de réflexion et d’action (Les Presses Africaines, Ouagadougou, 2010)
![]() Kourouma Ahmadou : En attendant le vote des bêtes sauvages (Éditions du Seuil, Paris 1998)
Kourouma Ahmadou : En attendant le vote des bêtes sauvages (Éditions du Seuil, Paris 1998)
Revues
![]() RFI
RFI
![]() Sciences-Cerveau-Transversalité des Savoirs humains / pierrebamony.com
Sciences-Cerveau-Transversalité des Savoirs humains / pierrebamony.com


Vos commentaires
1. Le 21 mars à 11:37, par kwiliga En réponse à : Afrique : Des pouvoirs politiques traditionnels et de leur avatar démocratique post-occupation des territoires africains par des puissances européennes
Bonjour Pierre Bamony,
M’ouais, ça fonctionnait bien à l’époque, on avait des valeurs à l’époque,...
Mais aujourd’hui, les seules valeurs qui nous restent, ne sont-elles pas cotées en bourse ?
J’ai bien peur que tu ne te fatigues pour rien, tu aurais mieux fait de venir rigoler au "club littéraire"...
Répondre à ce message